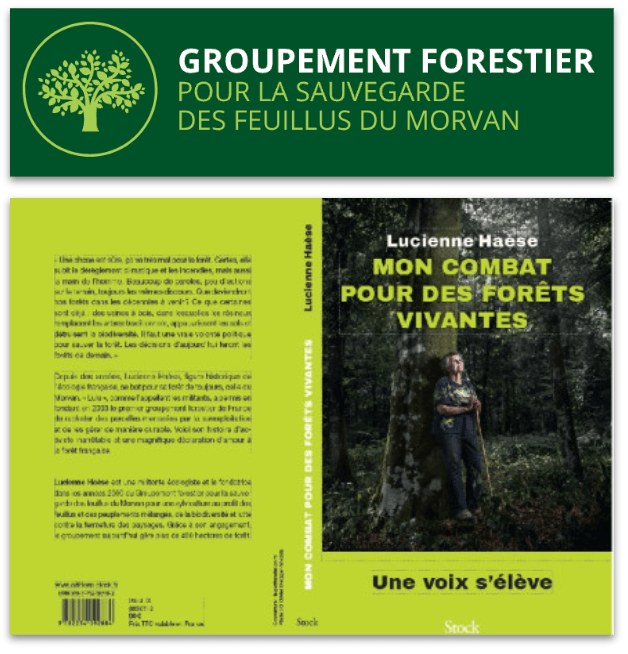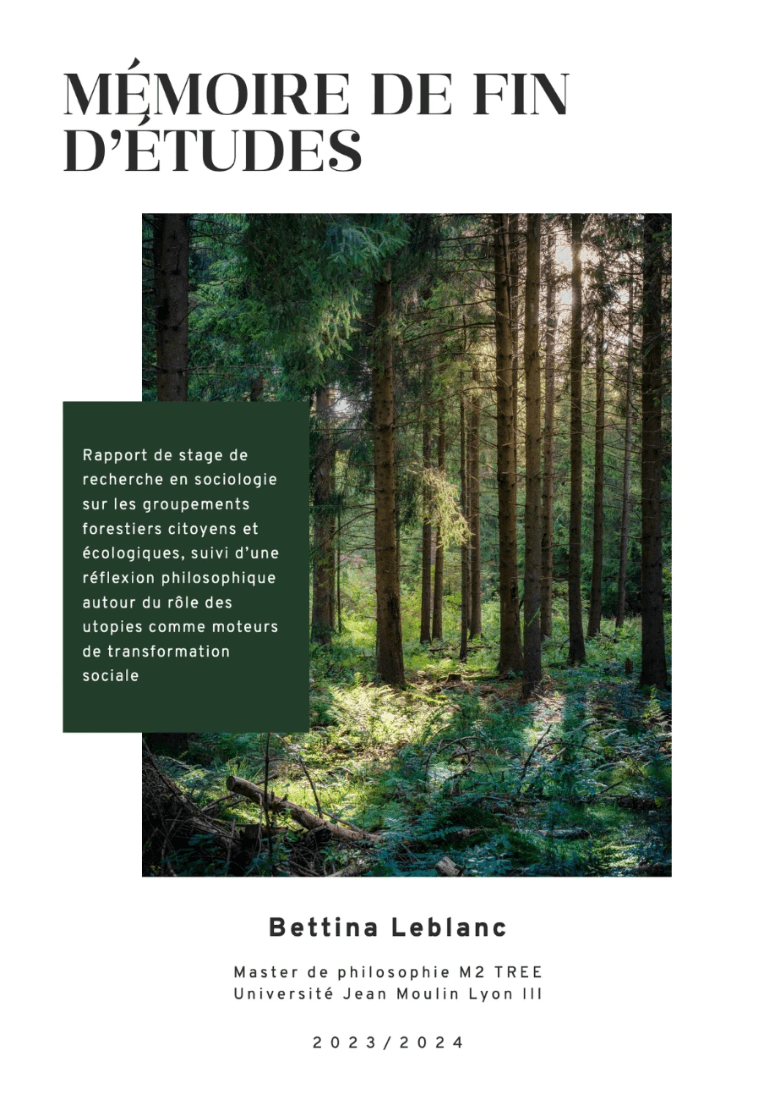Les Groupements Forestiers Écologiques : plus de 20 ans d'histoire

2003 : Lulu du Morvan passe à l'action
Lassée de voir les forêts de feuillus du Morvan victimes de coupes rases et remplacées par des plantations de résineux, Lucienne Haese lance le Groupement Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan (GFSFM) en 2003. Elle réunit l’épargne de citoyen(ne)s locaux et rachète des forêts du Morvan (Bourgogne) pour les soustraire aux pratiques destructrices de certains acteurs. Leur priorité : sauvegarder la forêt feuillue du Morvan et les forêts diversifiées.
Aujourd’hui, le GFSFM c’est 1200 associé(e)s et plus de 400 Ha de forêts achetées et gérées en Sylviculture Mélangée à Couvert Continu (SMCC). Ils précisent sur leur site que "l'achat de parts dans le Groupement ne doit pas être considéré comme un placement financier. Le GFSFM ne garantissant aucun rendement ni aucune plus-value, mais simplement le plaisir de participer à une action citoyenne pour la forêt".
C’est le tout premier Groupement Forestier de la sorte qui voit le jour en France. Deux autres se sont lancés depuis dans le Morvan pour adresser la même problématique de front et en réseau.
Avenir Forêt : le premier GFE "professionnel"
Pierre Demougeot et Susanne Braun, deux ingénieurs forestiers de métier, sont les co-fondateurs et les co-gérants d’Avenir Forêt, le plus grand GFE de France avec plus de 1.000 Ha de forêt et 300 associés. Forts de l’expérience du Groupement Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan, ils ont professionnalisé le modèle afin d’en faciliter la gestion et le développement. Créé en 2013, tous deux vivent depuis plusieurs années de la gestion des forêts du Groupement, prouvant ainsi que le modèle permet de vivre d'une gestion vertueuse de la forêt, dans le respect des écosystèmes.
Avoir des forestiers à la gérance des Groupements Forestiers Écologiques présente de nombreux avantages comme l'internalisation du pilotage des activités sylvicoles, la capacité à faire des estimations justes des biens forestiers sur le marché, et une plus grande confiance des associé(e)s.
D’autres Groupements Forestiers se sont créés depuis sur ce même modèle, c’est le cas du Turfu, de Green Forest et de Mielikki. Lancés par des forestiers de métier, l’ambition est d’atteindre un modèle économique viable et pérenne en pratiquant une sylviculture proche de la nature dans les forêts achetées. Chez Forêts Partagées, nous croyons en ce modèle et souhaitons accompagner d'autres forestiers à se lancer dans l'aventure.

La naissance du wiki
En 2020, Emmanuel Repérant, co-fondateur du GFC Lu Picatau et Pierre Demougeot, co-fondateur et co-gérant du GFE Avenir Forêt, décident de mettre en ligne un “wiki” - une base de connaissances en open-source, pour aider les citoyens et citoyennes à lancer leur propre Groupement Forestier Écologique sur leur territoire. Ils sont rapidement rejoints par des gérant(e)s et associé(e)s de structures "soeur" et bénéficient du soutien du Réseau pour les Alternatives Forestières.
Parmi les 32 Groupements Forestiers Ecologiques existants, plus des deux-tiers se sont lancés dans les quatre dernières années (2021-2025), grâce notamment à cet outil évolutif qui recense les éléments essentiels à la création et au développement du modèle. En plus du “wiki”, ce Groupe de Travail bénévole a animé la communauté en continu et organisait chaque année, les rencontres du foncier forestier pour rassembler ces collectifs.
C'est ce Groupe de Travail qui, pour aller plus loin dans ses missions, est devenu l'association Forêts Partagées en 2024.

Faire évoluer les pratiques et les mentalités
Les GFE sont par nature, des structures ancrées dans un écosystème local. Certains à l’échelle d'un département (Avenir Forêt en Corrèze), d'autres à l'échelle d'un massif (Green Forest dans le Vercors), voire à l’échelle d’un village (L’Escurau à Saint-Pierre-de-Frugie) ou d'une rivière (Troncs Communs et les rives de la Bourne). Les GFE permettent de :
- sensibiliser activement les associés (majoritairement locaux) qui apprennent en participant aux activités en forêt et qui contribuent aux décisions stratégiques ;
- offrir des perspectives de vente responsable à des propriétaires forestiers souhaitant se séparer de leurs forêts sans les faire tomber entre de mauvaises mains ;
- mettre la lumière sur une sylviculture douce, respectueuse des paysages et économiquement viable, pour avertir les élu(e)s de collectivités locales ;
- faire de la pédagogie auprès des Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF) à travers un cahier des charges exigeant en terme de respect des écosystèmes.
Un Groupement Forestier Écologique arrivé à maturité a des effets vertueux sur l'évolution des pratiques de la filière bois, et permet aussi une meilleure perception de cette dernière par les habitants.
Où trouver ces Groupements Forestiers Écologiques en France ?
Cliquez sur "voir en plein écran" pour une meilleure visibilité
Comment choisir dans quelle structure investir ?
La trentaine de Groupements Forestiers Écologiques (GFE) actifs ont en commun leurs principes ainsi que leur statut de GFF (une forme de SCI d'une durée de vie de 99 ans). En devenant propriétaires de forêts, ils permettent ainsi de “bloquer” la gestion vertueuse desdites forêts pendant toute leur durée de vie, assurant que les massifs soient gérés au bénéfice de la biodiversité.
Mais ces modèles restent un spectre de structures : certains ont plutôt l’âme d’associations créées par des amoureux de la forêts agissant en tant que bénévoles (qui se forment sur le tas à la sylviculture ou qui externalisent la gestion forestière), tandis que d’autres sont montés par des professionnels de la filière (des forestiers) qui souhaitent, à terme, vivre du modèle. Cette richesse de modalités est d’autant plus grande que ces différentes structures évoluent en porosité.
Le meilleur exemple est le Groupement Forestier de Sauvegarde des Feuillus du Morvan (GFSFM), qui s’est créé en tant que l'association "Autun Morvan Écologie", qui est devenue quelques années plus tard, un Groupement Forestier, dans le but se porter acquereur de forêts et de professionnaliser la gestion et la récolte de bois.
→ Les coordonnées de la gérance des GFE sont disponibles sur la Carte de Forêts Partagées (un peu plus haut). Certains ont des sites web et vous permettent de remplir un formulaire, d'autres vous proposent de leur écrire directement par mail, pour organiser un échange téléphonique.
Les questions à se poser pour bien choisir son collectif
- Est-ce que je souhaite m'associer à un GFE qui a des forêts à côté de chez moi ?
Les GFC/E sont des structures ancrées localement : la plupart des associé(e)s étant désireux de contribuer à la préservation des forêts à côté de chez eux, ils et elles investissent dans des GFC/E de proximité. Cela facilite également la participation aux éventuelles activités organisées en forêt, de rencontrer régulièrement d'autres associé(e)s, et de se joindre aux assemblées générales annuelles. Mais être du coin n'est en aucun cas une obligation pour investir dans un GFC/E, certain(e)s associé(e)s viennent de plus loin.
- Suis-sensible à des enjeux forestiers en particulier ?
La forêt est à la croisée d'injonctions économiques, sociales et environnementales. De fait, les GFC/E ont tous leur spécificité en terme de stratégie d'acquisition et de gestion, même si des Grands Principes (disponibles plus bas) sont respectés par tous. Des GFC/E vont se spécialiser dans l'acquisition de forêts de montagnes, de plaine ou aux abords d'une rivière. Certains vont faire le choix de ne récolter que du bois d'oeuvre, alors que d'autres produiront aussi du bois de chauffage. Des gérants de GFC/E auront comme objectif de rémunérer leur travail, tandis que d'autres voudront rester sur un format bénévole. Les enjeux sont donc adressés différemment par les GFC/E. À vous de voir ce qui colle le mieux à vos objectifs et à vos valeurs !
- Quel est le montant de l'investissement que je suis prêt à réaliser ?
Certains GFC/E acceptent des nouveaux associé(e)s tout au long de l'année, d'autres une fois par an. Les tickets d'entrée sont variables, allant de 100€ à 10 000 €, en fonction des objectifs de développement de la foncière. Le modèle de prise de décision peut également différer, des GFC/E pratiquent le "1 personne = 1 voix" tandis que d'autres sont au pro-rata du nombre de parts. Enfin, quelques GFC/E proposent de reverser des dividendes aux associé(e)s en fonction des bénéfices, d'autres une revalorisation des parts tous les 5 ans.
- Est-ce que je veux m'investir autrement que financièrement dans l'aventure ?
Lorsque les GFC/E sont lancés par des forestiers, ils ont les compétences pour gérer la forêt, mais cela ne les empêche pas d'organiser des activités sylvicoles plusieurs fois par an (visites de forêts, délimitation des parcelles, chantiers de plantations d'enrichissement...). Il arrive que les gérant(e)s aient besoin de soutien sur d'autres dimensions du GFC/E : administratif, recherche de forêts, communication... Les GFC/E issus de mouvements citoyens, ont souvent des modes de fonctionnement plus sociocratiques et laissent ainsi plus d'espace aux associé(e)s pour contribuer à la gestion au quotidien du Groupement, en rejoignant le Bureau ou un Comité.
- Est-ce que je souhaite m'associer à un GFE qui a des forêts à côté de chez moi ?
Découvrez la dernière étude de l'INRAE sur les GFCE

Introduction de l'étude
Ce mémoire est le fruit d’une enquête sociologique menée au printemps 2024 sur les groupements forestiers citoyens et écologiques (GFCE), des initiatives citoyennes qui cherchent, entre autres, à acheter des forêts pour les préserver des coupes rases. Mus par des idéaux démocratiques et de participation citoyenne, ils se présentent comme des modèles alternatifs aux logiques du modèle dominant et des pratiques de la filière conventionnelle, tant en termes de gouvernance qu’en matière de gestion sylvicole, qu’ils veulent plus respectueuse de l’environnement. Cette enquête est mise en perspective de façon plus large dans un second temps de réflexionphilosophique, qui explore le rôle des utopies comme moteur de transformation sociale. Les récits utopiques sont présentés comme des outils puissants de critique de l’ordre établi et de stimulation de l’imaginaire social, qui ouvrent la voie à des alternatives concrètes, qui peuvent être mises en œuvre dans les brèches du système socioéconomique dominant. Le mémoire conclut sur la nécessité de maintenir un dialogue constant entre les récits utopiques et leurs expérimentations pratiques dans le but d’impulser une transformation sociale profonde et durable.
Forêts Partagées
Association loi 1901 créée en 2024
Pour une gestion collective et écologique des forêts françaises